Entretien avec François-Henri Désérable

© Karine Bauzin
Nouveau roman, nouvelle visite à la Société de lecture de Genève où il avait déjà enthousiasmé son public pour « Un certain Monsieur Piekielny » en 2019 : l’occasion rêvée de s’entretenir avec François-Henri Désérable à propos de « Mon maître et mon vainqueur », juste avant qu’il ne soit distingué par le Grand Prix de l’Académie française 2021 !
Pour retrouver mon billet sur le livre de François-Henri Désérable, « Mon maître et mon vainqueur » (Gallimard), c’est ici !
Julie Vasa : Quatre ans sans publication de livre alors que tes précédents étaient séparés de deux ans… Qu’as-tu fait pendant tout ce temps ?
François-Henri Désérable : J’étais en train d’écrire un récit de voyage sur les traces de Che Guevara en Amérique du Sud – un voyage que j’ai réalisé voici quatre ans. Et puis, à la suite d’une histoire d’amour passionnelle, j’ai cessé d’écrire pendant un an parce que j’étais dans un désarroi assez profond. Finalement, pour me remettre de ce chagrin d’amour, j’ai commencé quelque chose qui n’a absolument aucune originalité : j’ai écrit des poèmes ! Mon intention initiale a alors été d’écrire un recueil de poèmes.
J.V. : Une intention qui a donc passablement évolué ?
F.-H. D. :  Oui, je me suis ravisé, notamment à la suite d’une conversation avec Maria Pourchet qui elle aussi, écrivait un roman sur la passion amoureuse, « Feu ». Maria m’a convaincu d’en faire un roman.
Oui, je me suis ravisé, notamment à la suite d’une conversation avec Maria Pourchet qui elle aussi, écrivait un roman sur la passion amoureuse, « Feu ». Maria m’a convaincu d’en faire un roman.
J’ai donc pris un certain nombre de mes poèmes et je les ai enrobés de fiction. J’ai essayé de restituer tous les sentiments qui m’avaient traversé dans une histoire d’amour qui n’est pas la mienne, une histoire fictive.
J.V. : C’est une démarche assez originale de partir de poèmes pour écrire une fiction ?
F.-H. D. : Oui, je crois. L’amour est à l’origine de poèmes qui ont ensuite trouvé une place au sein d’un roman. C’est peu commun.
J.V. : À te lire, on pense forcement au juge du livre de Tanguy Viel dans son roman « Article 353 du Code pénal », que tu remercies d’ailleurs à la fin du livre. Dans quelle mesure celui-ci t’a-t-il inspiré ?
F.-H. D. : Quand j’ai débuté l’écriture de ce livre, je souhaitais absolument que le narrateur soit dans le bureau d’un juge d’instruction. J’avais lu ce roman de Tanguy Viel qui m’avait énormément plu et je lui ai écrit pour lui demander l’autorisation de muter « son juge » de Brest à Paris. Et il m’a répondu très gentiment en m’y autorisant !
J.V. : J’ai le souvenir de t’avoir publié dans la Revue Lamy Droit des affaires, rubrique « Droit international et européen des contrats d’affaires » : inclure un juge dans un de tes livres est-il lié à ton passé de juriste ?
F.-H. D. : Alors non, pas du tout ! La passion amoureuse est un thème assez éculé et quand on écrit dessus, il faut essayer de trouver une forme qui soit nouvelle. Et puis je voulais que mon narrateur puisse à la fois raconter au juge cette histoire tout en faisant de la rétention d’information, révéler des choses aux lecteurs qu’il dissimule à dessein au juge.
J.V. : Quelle influence ton passé de joueur de hockey exerce-t-il sur ton écriture et notre entretien aujourd’hui ?
F.-H. D. : Influence certaine pour aujourd’hui : j’ai pris un coup de crosse il y a une dizaine de jours, j’ai le nez cassé, plusieurs points de suture… Sur l’écriture, le hockey m’a appris à avoir une certaine discipline – cela dit, il y a de longues périodes où je n’écris pas la moindre ligne.
J.V. : Comment décrirais-tu les personnages que tu mets en scène, en commençant peut-être par Tina ?
F.-H. D. : Tina est une comédienne d’une trentaine d’années. Elle a deux enfants. Elle lit beaucoup de poésie, c’est d’ailleurs grâce à la poésie qu’elle est venue au théâtre, notamment celle de Verlaine. Elle est en couple avec Edgard, un homme avec qui elle a deux enfants, des jumeaux, et qu’elle est sur le point d’épouser. Elle l’aime et néanmoins, s’éprend de Vasco. Débute alors une passion tumultueuse. Comment la qualifier… ?

« L’une des définitions qu’on peut donner de la passion amoureuse, c’est la raison qui rend les armes. »
J.V. : Je l’ai trouvée flamboyante…
F.-H. D. : Agaçante aussi, sans doute. Tour à tour exaltée et désespérée.
J.V. : Et Vasco ?
F.-H. D. : Il est conservateur à la Bibliothèque Nationale de France. Position grâce à laquelle il va pouvoir emmener Tina dans la Réserve des livres rares et anciens et lui montrer les trésors qu’elle recèle, notamment la Bible de Gutenberg, avant de connaître Tina au sens biblique du terme… Il tombe amoureux de cette fille, qui ne vient pas combler un manque, mais en créer un. Puis il perd pied. Voilà une définition que l’on pourrait donner de la passion amoureuse : c’est la raison qui rend les armes. La raison va dans cette histoire être totalement mise de côté – par Tina autant que par Vasco. Baudelaire a écrit : « Ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour, c’est que c’est un crime où l’on ne peut pas se passer d’un complice ». Eh bien Tina va trouver en Vasco le complice de cette histoire d’amour.

Bibliothèque Nationale de France – Salle de lecture de la Réserve des livres rares
© Béatrice Lucchese /BnF
J.V. : Le narrateur de l’histoire joue lui aussi un rôle dans cette histoire ?
F.-H. D. : Le narrateur, c’est moi ! Il connaît les deux protagonistes de l’histoire. Il est le confesseur de l’un et le confident de l’autre. Situation compliquée… Il va se faire l’exégète des poèmes de Vasco auprès du juge pour l’aider à dénouer les fils de cette passion amoureuse et résoudre cette enquête tout en préservant les intérêts de ses amis.
J.V. : Selon toi, et comme Tina, l’amour, la jouissance, sont-ils des moyens de supporter le fardeau qu’est, je te cite, « le métier de vivre » ?
F.-H. D. : « Le métier de vivre », c’est le titre du Journal intime de Pavèse, très beau titre d’ailleurs… Quand j’ai commencé ce roman, je n’avais pas de titre. Il faut dire que Kundera s’était accaparé tous les meilleurs titres pour les histoires d’amour : « L’insoutenable légèreté de l’être », « La valse aux adieux », « Risibles amours »… Quand j’ai découvert ce poème de Verlaine assez méconnu, qui se trouve dans un recueil lui aussi assez méconnu, j’ai su d’emblée que « Mon maître et mon vainqueur » serait le titre de mon livre.
« Es-tu douce ou dure ? Est-il sensible ou moqueur / Ton coeur / Je n’en sais rien mais je rends grâce à la nature / D’avoir fait de ton coeur mon maître et mon vainqueur ».
C’est un peu « tarte à la crème » mais je crois qu’il y a beaucoup de moi dans chacun des personnages – mais y compris dans leurs travers. C’est pour cette raison que j’éprouve sans doute de l’indulgence et de la compassion à leur égard, par complaisance avec moi-même… Il y a certains éléments biographiques dans chacun de ces personnages.
© Karine Bauzin
J.V. : Ton livre porte la dédicace « Bien à toi » qui prend tout son sens à la fin de la lecture. C’est émouvant…
F.-H. D. : Tu sais, cinquante ans après avoir écrit « Les souffrances du jeune Werther », Goethe a une conversation avec Eckermann et lui dit « Il serait fâcheux qu’au moins une fois dans sa vie chacun n’ait pas une époque où Werther lui semble avoir été écrit spécialement pour lui ». Il y a sans doute une personne en ce monde qui pensera que ce livre a été écrit spécialement pour elle.
J.V. : Est-on réellement libre d’aimer qui l’on veut ?
F.-H. D. : En Occident aujourd’hui, il me semble que oui. Ce qui n’empêche pas parfois de se mettre dans des situations inextricables. J’espère que mon livre ne sera pas compris comme un éloge de l’adultère, ce n’est pas du tout mon intention. C’est simplement une tentative de restitution des sentiments qui vous traversent lorsque vous êtes aux prises avec passion amoureuse – laquelle est toujours douloureuse.
La première acception de la passion, c’est celle du Christ. Ce sont les souffrances endurées par le Christ. Et ces souffrances sont consubstantielles à la passion. J’écoutais Maria Pourchet récemment chez Laure Adler sur France Inter. Elle disait que la passion s’achevait toujours très rapidement, que c’était toujours un début incandescent d’une histoire qui transformait en sentiment assez doux ou qui se terminait abruptement. Finalement, la passion arrive toujours avec son cortège de regrets parce que l’on sait que c’est un état transitoire et qui prend fin assez rapidement.
J.V. : Quels sont tes habitudes d’écriture ? Utilises-tu un cahier Clairefontaine de 96 pages en 21/29,7, à grands carreaux… ?
F.-H. D. : Alors oui, les poèmes, je les ai écrits à la main sur un cahier Clairefontaine, mais pour la prose, j’utilise un ordinateur. Je n’écris pas tous les jours. J’essaie mais ça ne vient pas forcément. Il y a des moments totalement inféconds, où l’on peut désespérer de toute littérature. Mais quand ça vient, quand ça marche, il y a de la jubilation. Le plus clair de mon temps, je le passe à lire. Il y a une phrase de Borges que je cite dans quasiment chaque entretien, et je crois que tout écrivain pourrait l’endosser : « Que d’autres se flattent des pages qu’ils ont écrites ; moi, je suis fier de celles que j’ai lues ». Eh bien je crois que s’il fallait sacrifier la lecture ou l’écriture, je sacrifierais l’écriture. Le problème est qu’un bon livre me donne toujours une farouche envie d’écrire.
J.V. : Quels sont les livres qui t’ont marqué récemment ?
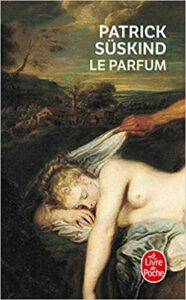 F.-H. D. : Je pense à un livre que j’ai relu récemment, « Le parfum » de Patrick Süskind. Je l’ai lu à vingt ans et je craignais d’être un peu déçu à la relecture. Or je l’ai trouvé absolument fabuleux : il parvient à être grand public sans jamais abdiquer son exigence littéraire. C’est un livre écrit le plus souvent à l’imparfait ou au passé simple, avec une langue riche, foisonnante, avec des latinismes, avec un héros qui n’a rien de sympathique, rien de feel good. Il m’a stupéfait !
F.-H. D. : Je pense à un livre que j’ai relu récemment, « Le parfum » de Patrick Süskind. Je l’ai lu à vingt ans et je craignais d’être un peu déçu à la relecture. Or je l’ai trouvé absolument fabuleux : il parvient à être grand public sans jamais abdiquer son exigence littéraire. C’est un livre écrit le plus souvent à l’imparfait ou au passé simple, avec une langue riche, foisonnante, avec des latinismes, avec un héros qui n’a rien de sympathique, rien de feel good. Il m’a stupéfait !
J.V. : Ecrire sur une histoire d’amour a-t-il été thérapeutique, inspirant, éprouvant… ?
F.-H. D. : Une autre définition que l’on pourrait donner de la passion amoureuse : l’impossibilité de détacher son esprit, sa pensée de la personne que l’on aime. Je ne pouvais tout simplement pas écrire sur quoi que ce soit d’autre puisque tout mon esprit était tendu vers l’histoire que j’avais vécue. Ce n’est pas par désœuvrement que j’ai écrit cette histoire mais simplement parce qu’il m’était impossible d’écrire sur un autre sujet. Ce livre est assez différent dans son inspiration et dans son thème que mes précédents. Jamais je n’avais prévu d’écrire sur ce sujet ou, en tous cas, pas maintenant. J’aurais pu ne rien faire mais, dans ce cas-là, à quoi bon être écrivain si c’est pour s’abstenir d’écrire sur ce qui nous touche au plus intime ?
J.V. : A-t-il été compliqué, impressionnant, de te lancer dans ce qu’il y a de très classique en littérature, ce trio amoureux ?
F.-H. D. : Je lis beaucoup et je trouve rarement mon compte dans les histoires d’amour en littérature. On a parlé de « Feu » tout à l’heure de Maria Pourchet. Il y aussi Annie Ernaux qui a très justement écrit sur la passion amoureuse avec « Passion simple » ou « L’occupation ». Pour moi, le grand roman d’amour contemporain, c’est la tétralogie « M.M.M.M. » de Jean-Philippe Toussaint : ce qui a été écrit de plus beau sur l’amour (en tous cas, ces dernières années). Sinon, LE livre qui m’a donné envie d’écrire, c’est « Belle du seigneur », d’un écrivain que les genevois connaissent bien. Mais pour autant, je lis rarement des histoires d’amour qui m’emportent vraiment. Je trouve cela souvent niais… comme si c’était un genre réservé aux lectures faciles. Je suis fasciné par les pudeurs de gazelle des écrivains qui écrivent sur l’amour et qui, souvent, font l’économie des scènes de sexe.
J.V. : As-tu trouvé l’exercice difficile ?
F.-H. D. : Je n’en avais jamais écrit… c’est en tous cas périlleux ! On peut vite tomber dans le mièvre ou le mauvais goût. Il y en a deux dans ce roman et j’ai essayé de faire en sorte qu’elles ne soient pas totalement ridicules !

« À quoi bon être écrivain si dès lors qu’il nous arrive quelque chose de sensible, on s’abstient d’écrire dessus ? »
J.V. : As-tu passé beaucoup de temps à la BNF ?
F.-H. D. : Oui. Olivier Chaudenson, le directeur de la maison de la poésie, m’a offert la possibilité d’y faire une résidence : j’avais en somme quartier libre à la BnF, je pouvais aller dans n’importe quel département, et c’est comme cela que j’ai pu accéder à la réserve des livres rares. C’est une pièce fermée avec un accès très sécurisé et à laquelle seule une poignée de conservateurs ont accès. Il y a là les épreuves corrigées des Fleurs du Mal de Baudelaire, la Bible de Gutenberg, le manuscrit de La recherche du temps perdu, d’autres de Victor Hugo… C’est un endroit vraiment extraordinaire pour les bibliophiles. J’ai pu consulter tout cela et c’est pourquoi j’ai fait de Vasco un conservateur à la BnF.
J.V. : Quel type d’émotion te traversent lorsque tu découvres le manuscrit d’un auteur illustre ?
F.H.-D : J’ai l’impression de voir la pensée en action, une sorte de matérialisation de la pensée. C’est le cas lorsqu’on voit Apollinaire qui supprime toutes les virgules sur les épreuves corrigées d’Alcools ou Baudelaire qui en rétablit une sur celles des Les Fleurs du Mal, en précisant dans la marge « Je tiens absolument à cette virgule ».
J.V. : Connais-tu la Fondation Martin Bodmer en Suisse ?
F.H.-D : Bien sûr ! Et j’ai eu le privilège d’une visite guidée avec Nicolas Ducimetière, son directeur. Il y a en ce moment une merveilleuse exposition sur Dante.
J.V. : La littérature et les lieux qu’elle imprègne sont-ils un moyen imparable de séduire l’autre ?
F.-H. D. : Je ne sais pas. Mais enfin, c’est grâce à la littérature que j’ai rencontré une fille extraordinaire, qui partage ma vie aujourd’hui.
J.V. : Magnifique ! Et très romantique ! Peux-tu m’en dire davantage… ?
F.-H. D. : Pendant le confinement, j’ai reçu une lettre, magnifique, de quatre pages. Une lectrice m’expliquait qu’elle s’était retrouvée confinée à Nice chez son beau-père et sa mère, qu’elle était tombée sur l’un de mes livres dans la bibliothèque, en avait lu la quatrième de couverture et l’avait reposé sur l’étagère ! Puis elle a enfilé sa paire de baskets, et elle est partie courir. Or sur son chemin s’est trouvée une plaque commémorative rendant hommage à Romain Gary, qui a vécu à Nice. Rentrée chez elle, elle a donc repris le livre, et elle l’a lu. Elle m’a écrit cette lettre non pas pour me parler du livre mais pour me raconter tous les hasards qui l’avaient amenée à le lire. Je ne savais pas comment lui répondre, sa lettre était si belle… Finalement, je l’ai appelée pour la remercier, puis nous avons parlé longtemps, puis nous nous sommes vus après le confinement, et aujourd’hui, cela fait un an et demi que nous sommes ensemble.
J.V. : Tu signes un roman d’amour puissant, truffé de références littéraires. On sent chez toi un amour de la littérature. Tu cites d’ailleurs de nombreux auteurs. En quoi cela te paraît-il nécessaire de citer des écrivains que tu admires ?
F.-H. D. : Je pourrais répondre par une citation de Paul Morand : « Les citations sont les béquilles des écrivains infirmes » ! Citer peut passer pour un étalage de culture, je pense au contraire que c’est faire preuve d’humilité. C’est dire : d’autres ont parlé de telle ou telle chose avant moi, avec une maestria que je n’ai pas, alors je préfère vous offrir leurs mots éclatants plutôt que les miens qui sont bien pauvres ! Si je dois par exemple donner une définition de l’amour, plutôt que d’en échafauder une un peu bancale, je préfère citer Barthe qui dans « Fragments d’un discours amoureux », parle de « l’assomption démentielle de la dépendance ».
J.V. : Penses-tu, comme ton narrateur, que l’amitié est une forme inachevée de l’amour ?
F.-H.D. : Il m’est arrivé de le penser mais je ne suis pas certain de le penser encore aujourd’hui !
J.V. : Et selon toi, une rupture amoureuse est-elle pire qu’un deuil ?
F.-H.D. : Pour le coup, j’y souscris tout à fait ! C’est le deuil pour soi-même d’une personne qui est encore en vie, que d’autres peuvent voir et entendre et sentir et toucher… Je parlais tout à l’heure Des souffrances du jeune Werther : je crois qu’il y a un basculement dans la vie qui s’opère le jour où l’on cesse de railler les souffrances du jeune Werther et celui où, les ayant éprouvées, on les fait siennes, on les endosse. Un chagrin d’amour peut être une épreuve encore plus difficile à traverser qu’un deuil. Je comprends le suicide par amour. Un chagrin d’amour peut entraîner une désintégration totale de son être. C’est une si riche épreuve philosophique, disait Cioran, que d’un coiffeur elle fait un émule de Socrate. Le chagrin d’amour a au moins cette vertu-là : il vous donne matière à penser.
J.V. : Quels sont tes liens avec la Suisse aujourd’hui ?
F.-H. D. : Ils ont d’abord été cantonnés à des patinoires : je connais plein de petites villes suisses liées à ma carrière de joueur de hockey. Désormais, quand je viens en Suisse, c’est pour parler de mes livres. J’étais récemment à la Société de lecture de Genève, un endroit merveilleux.
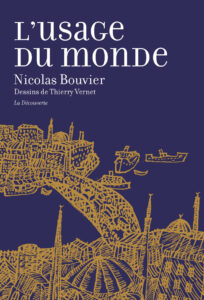
Mes liens avec la Suisse sont davantage des liens avec les écrivains suisses, dont certains ont beaucoup compté pour moi. Le premier n’est pas Suisse mais y a vécu longtemps : Albert Cohen. Je crois que le dernier livre qui a le plus compté pour moi et qui a, d’une certaine manière, façonné ma vision de l’existence, c’est « L’usage du monde » de Nicolas Bouvier. Quand je suis venu à la Société de lecture il y a maintenant trois ans, Delphine de Candolle m’a fait ce plaisir immense de me présenter à Emmanuel Bouvier, le fils de Nicolas Bouvier et nous sommes allés sur sa tombe au cimetière de Cologny. J’ai beaucoup d’admiration pour Nicolas Bouvier, grand voyageur, grand écrivain et, on le sait moins, grand poète.
J.V. : Avoir du style, dans la vie comme en écriture, est-ce un objectif que tu poursuis ?
F.-H.D. : En écriture, oui, c’est certain et comme la vie se confond avec l’écriture… Les livres dépourvus me tombent des mains. On parle de « rentrée littéraire » mais il s’agit davantage d’une « rentrée des livres », dont certains relèvent de la littérature et d’autres non. Le style, il me semble, c’est le timbre et l’intensité d’une voix si singulière qu’elle s’impose en quelques lignes. Voilà ce à quoi j’aspire, voilà ce que je poursuis. ◼︎
Clin d’œil
La première fois que j’ai lu François-Henri Désérable, c’était… il y a fort longtemps, alors que nous étions juristes tous les deux ! Il écrivait des articles juridiques et je les publiais ! Une autre époque … mais une certaine plume et un nom qui m’avaient alors marquée !



Je n’ai pas été la seule puisqu’un autre des auteurs que je publiais à l’époque, le professeur Cyril Nourissat, fait lui aussi aujourd’hui un clin d’œil à son ancien étudiant ! Insolite !




Recevez mes chroniques par mail pour vous inspirer !
Pensez à valider votre inscription à partir du mail reçu (spams à vérifier !)
Votre inscription a bien été prise en compte